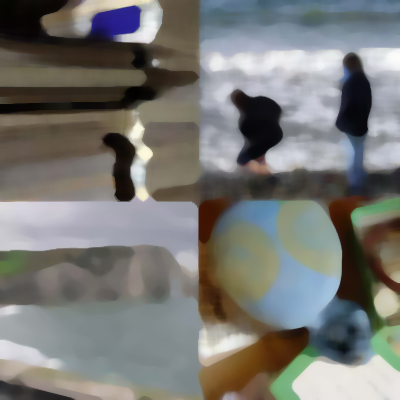
L'insouciance (fragment 20)
La voiture filait à vive allure vers la Normandie. Nous traversions la Beauce... Plate ! Désespérément plate. Je n’ai jamais aprécié l’absence de relief dans le paysage. Je ne sais pas dire pourquoi, peut-être la monotonie apparente, l'absence de repères..? J’avais donc décidé de l’ignorer. Je m’étais installé sur la banquette arrière pour finir la lecture mainte fois recommencée de Au dessous du volcan. C’est dans cette position, le dos callé contre la portière, que j’ai fini (bu?) d'un trait ce roman.
« Un livre dont on ne revient pas… » m’avait dit un ami en me tendant cette édition de poche, achetée le matin même sur les quais, à un bouquiniste. Sur le moment je n’avais pas relevé. Mais cette phrase, plus peut-être que le livre lui-même, a longtemps trotté dans ma tête avant que je ne me décide à soulever la couverture. « On n’en revient pas… ». Entre temps cet ami était mort, et le livre avait été rangé sur une étagère.
Sa tranche avait du encore jaunir un an ou deux après cette disparition brutale. Et puis un matin, sans savoir pourquoi, j’avais tiré le livre du rayonnage, passé la préface et commencé à lire quelques pages. Reposé sur le bureau, il a du encore attendre au moins six mois.
C’est souvent comme ça pour les livres. Je ne lis jamais d’un coup. Je commence, je suis pris d’un vertige, je ne comprends rien, je laisse traîner le bouquin. Pas trop loin, et j’attends le moment où inévitablement il viendra engloutir la réalité et m’engloutir avec.
Celui-là pourtant fut de nouveau enseveli sous des piles de papier avant que cet échafaudage instable ne finisse à nouveau par me le ramener au jour après s’être totalement répandu sur le carrelage. Ainsi, c’est dans une coulée de feuilles, de photographies et autres tickets que Au dessous du volcan refaisait surface. La seconde tentative ne m’amena pas beaucoup plus loin que la première.
C’est cette année là que j’ai quitté le sud pour l’est de la France. La lumière avait changé, la vie était moins douce, le froid de l’hiver me tenait près du feu. Le livre m’est revenu entre les mains en ouvrant les cartons. C’était peut-être le moment ? Cette fois-ci, j’allais plus loin, je me familiarisais avec les personnages, je commençais même à me représenter la géographie de cette ville… Parfois mes nuits se peuplaient de cantinas, d’une lumière crue, de paysages sauvages et isolés… Cependant, le travail de peinture qui m’occupait alors mobilisait davantage encore mon attention et le livre fit encore un séjour prolongé au chevet du lit.
Et puis il y avait eu ce coup de téléphone et cette proposition d’un week-end en Normandie, « La mer te fera du bien… ! ». J’ai glissé le livre dans un sac avec le minimum d’affaires et j’ai pris le train jusqu’à Dreux.
C’étaient les conditions idéales pour reprendre à zéro la lecture de ce roman dont on ne revient pas.
Quand j’ai refermé le livre, la voiture venait de stationner sur un parking, face à la mer. Sur ma gauche je voyais se découper les falaises d’un tableau de Courbet. J’étais ivre et vaseux sans pourtant avoir bu une seule goutte. C’était comme si, par une lente perfusion , les mots chargés de vapeurs d’alcool s’étaient infiltrés dans mes veines. Nous sommes descendu marcher sur la plage de galets. Le ressac roulait dans mon ventre. Michelle parlait d’un souvenir d’enfance que lui évoquaient les falaises blanches, Patrick arqué face aux vagues, les jambes du pantalon retroussées, faisait des ricochets. Dans la brise légère remontaient du balancement d’une étendue huileuse, des relents d’algues décomposées. Je regardais rouler entre mes doigts le petit crâne anthracite pioché (au hasard) dans le lit de pierres polies, grises et roses.